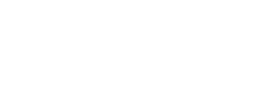QU’EST-CE QUE LE DROIT COLLABORATIF ?
Le processus collaboratif se donne pour objectif d’organiser le déroulement de la négociation, de créer les conditions permettant d’aboutir à un accord pérenne. Ce cadre est matérialisé par un contrat signé par les deux époux, partenaires ou concubins, d’une part, et leurs avocats, d’autre part, qui s’engagent expressément à rechercher une solution constructive et apaisée à leur conflit, dans le respect et la dignité.
Pour éviter les rapports de force destructeurs, les parties et leurs avocats s’engagent notamment à ne pas saisir le juge (ou menacer de le saisir) pendant toute la durée des négociations et tant qu’un accord n’a pas été trouvé. Pour garantir cette obligation, le contrat impose aux avocats, en cas d’échecs des négociations, de ne plus assister leurs clients dans la phase judiciaire contentieuse. Cela crée une dynamique extrêmement puissante, où toutes les énergies sont mobilisées pour trouver un accord global, puisque chacun a intérêt à faire en sorte que le processus fonctionne : les avocats pour ne pas perdre le dossier, les justiciables pour éviter d’avoir à tout recommencer avec un autre conseil.
La clé de la réussite et de l’efficacité du processus repose sur les « règles du jeu » auxquelles tant les parties que leurs avocats se soumettent : outre un engagement de confidentialité renforcée, chacun s’engage à la transparence, c’est-à-dire à communiquer toutes les informations et données nécessaires à la résolution de bonne foi des problèmes.
Dans ce cadre, les parties vont pouvoir s’exprimer en toute sécurité sur les causes réelles de leur litige et faire valoir toutes leurs préoccupations, sans crainte que l’autre ne saisisse le juge, et au rythme qu’elles auront défini.
S’il est difficile de se parler lorsque les souffrances de la rupture sont encore présentes, tout l’enjeu du processus est précisément de restaurer la confiance en offrant des outils indispensables aux avocats, tels que l’écoute active, la reformulation et la négociation raisonnée, qui permettent à chacun d’exprimer ses inquiétudes, ses besoins, de définir ses priorités. Une place particulière est ainsi donnée aux émotions, aux affects souvent négligés dans des procédures classiques, mais dont l’affleurement et l’expression sont pourtant indispensables à l’émergence d’un accord solide. C’est en effet souvent parce que des non-dits auront subsisté que les conflits rejaillissent. Une personne adhérera d’autant plus volontiers à un accord qu’elle aura le sentiment d’avoir été pleinement entendue.
Ces négociations ont lieu lors de trois à six rencontres plénières, réunissant les deux parties et leurs avocats. Elles ont pour finalité d’échanger toutes les informations nécessaires qui constituent des éléments objectifs, de déterminer les besoins et les priorités de chacun, de répertorier les points d’opposition, d’inquiétude, mais aussi les points d’accord. Elles doivent permettre de rechercher toutes les options possibles afin de déterminer ensuite celles qui, réglant la globalité du différend, seront acceptables par les deux parties.
Ainsi, dans un dialogue renoué, grâce aux garanties souscrites par le contrat collaboratif, les parties élaborent une solution juste et raisonnable, sans gagnant ni perdant, dans un esprit de conciliation préservant les intérêts en présence afin que, sur le long terme, et notamment en présence d’enfants, la solution soit viable.
EXTRAIT DE LA REVUE ÉTUDES - AVRIL 2014 – ARTICLE DE JEAN-LUC RIVOIRE ET LORRAINE BERTAGNA